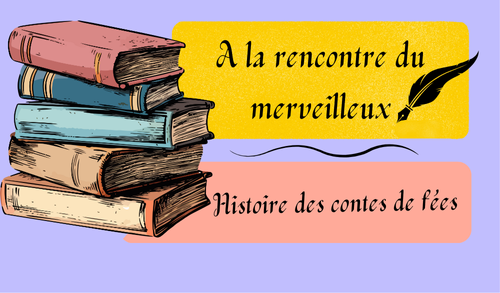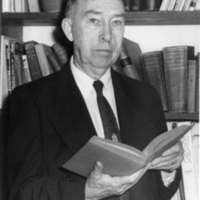Ecrire un conte de fées : histoire d'un genre littéraire
Cette première section introduit à l’histoire des contes de fées. Genre littéraire issu des mythes et légendes orales, il s’inscrit dans une tradition du récit fantastique. Héritier de l’oralité, le conte de fées que nous connaissons aujourd’hui a été mis en forme en France à la fin du XVIIe siècle. Les conteuses et conteurs se saisissent des histoires orales et fixent leurs récits. Les siècles suivants élargissent cette conquête des contes à l’Europe avec la rédaction de grands recueils.
Le genre littéraire se constitue ainsi autour du récit oral et de sa transcription. Cela explique également la multitude de versions pour un seul et même conte. Cendrillon en est le parfait exemple. En France, la version de Charles Perrault intitulée Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre est publiée en 1697 dans le recueil Les contes de la mère l’Oye. Version la plus connue, c’est aussi la plus douce et enchanteresse. Pour ce même conte, nous retrouvons également une version des frères Grimm intitulée Aschenputtel. Ici, la morale du conte n’est pas le pardon de Cendrillon mais la punition. Ses belles-sœurs sont en effet torturées et se font arracher leurs yeux. Il existe également une version corse de cette histoire orale. Genderella ne reçoit cette fois pas de carrosse mais trois fruits à coque se transformant en robes de bal.
Cet archétype de l’héroïne persécutée a été étudié et l’on en compte près de 700 versions d’après l’ethnologue suédoise Anna Birgitta-Rooth. Pour étudier les contes de fées, il est possible de s’appuyer sur la Classification Arne-Thompson-Uther (ATU). C’est un système international qui indexe les contes populaires par types narratifs. Initiée par le Finlandais Antti Aarne en 1910, elle a été enrichie par l'Américain Stith Thompson en 1928 et 1961, puis par l'Allemand Hans-Jörg Uther en 2004. Cette classification attribue à chaque type de conte un numéro unique, facilitant ainsi l'identification et l'étude des motifs récurrents à travers différentes cultures. Les contes sont répartis en quatre grandes catégories : les contes d’animaux mettant en scène ces derniers comme personnages principaux (ATU 1-299), les contes « ordinaires » (ATU 300-1199), les contes facétieux (ATU 1200-1999) et les contes à formules (ATU 2000-2340). Ces derniers sont caractérisés par des répétitions et sont souvent sans fin définie. Cette structure permet aux chercheurs de comparer les contes du monde entier en les regroupant dans des typologies définies.