S'inspirer de l'oralité et des récits médiévaux
Le conte est d'abord une parole vivante, transmise de génération en génération, prenant des formes variées. Parfois, un inconnu modifiait ou inventait, créant ainsi une nouvelle branche de l'immense arbre des contes. L'oralité incarne la sociabilité : les rares récits anciens qui relatent les conteurs et leurs pratiques évoquent principalement des veillées, des mariages, des fêtes ; autant de rassemblements au sein d'une société rurale, où le conte devient un rite social et le conteur un lien vivant entre les générations. La figure symbolique de ma mère l’Oye, souvent dépeinte sous les traits d'une vieille femme, joue un rôle central dans la transmission des contes. Toutefois, c'est généralement un homme, expert du genre, qui porte le conte de ferme en ferme et en fait son moyen de subsistance.
Le Moyen Âge est le terreau du conte occidental. En effet, c'est au travers de ces récits qu'apparaissent les premières traces du merveilleux. Les sorcières, dragons et autres éléments fantastiques peuplant les sagas médiévale sont un premier pas vers l'écriture des contes. Au-delà des chansons de gestes, d'autres romans médiévaux tel que le Roman de Renart évoquent des premiers éléments merveilleux. Dans cet univers où les animaux sont doués de la parole, il est difficile de ne pas voir en Renart le futur Chat Botté. Cet anthropomorphisme fascine les hommes. Cette double paternité, les contes oraux et les récits médiévaux, permet aux contes merveilleux et à leurs auteurs de bénéficier d'une montagne de références pour construire leurs histoires.
Enfin, c'est à la Renaissance que les contes continuent à se figer en un futur genre littéraire. Citons notamment l'oeuvre phare de François Rabelais, Gargantua. Le géant à grand appétit a de nombreuses caractéristiques communes avec ces cousins des XVIIe et XVIIIe siècles.
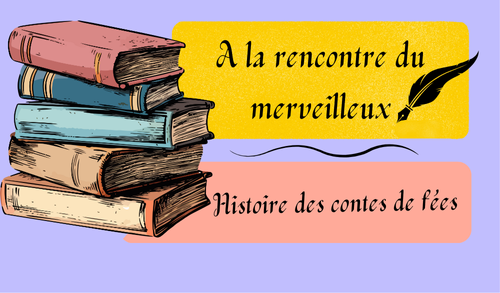
![[Illustrations_de_Les_Contes_de_[...]Doré_Gustave_btv1b2200191h_1.jpeg [Illustrations_de_Les_Contes_de_[...]Doré_Gustave_btv1b2200191h_1.jpeg](https://pireh.univ-paris1.fr/patrimoine/2024-2025/GPC/G4/files/fullsize/0fcd7f1d773c16254edf30b20ff1934a.jpg)
