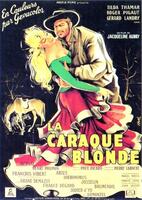L’agriculture au bord du fleuve, bienvenue en Camargue !
Les pratiques agricoles le long du Rhône sont profondément influencées par la présence du fleuve, qui façonne les choix culturaux et les méthodes employées. Les sols fertiles et l'accès à l'eau favorisent des activités telles que la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage, contribuant à une culture rhodanienne distincte, intimement liée au milieu fluvial. Ces activités économiques permettent aux communautés locales de vivre de manière durable, en tirant parti des ressources naturelles offertes par le Rhône.
Ainsi, les relations entre les habitants et le Rhône sont au cœur d'une dynamique où les pratiques agricoles, façonnées par le fleuve, assurent la pérennité économique et culturelle des territoires riverains.
La Camargue
En Camargue, région emblématique située dans le delta du Rhône, l'agriculture et l'élevage occupent une place prépondérante. La transmission des savoir-faire agricoles, notamment en matière d'irrigation et d'élevage, est cruciale pour préserver l'identité culturelle camarguaise. Les agriculteurs et éleveurs perpétuent des techniques traditionnelles tout en intégrant des pratiques agroécologiques pour répondre aux défis environnementaux actuels.
L'élevage
L'élevage extensif de chevaux de race Camargue et de taureaux noirs, adaptés aux marais et sansouïres, est une pratique ancestrale qui valorise les zones les plus hostiles et infertiles de la région. Ces chevaux sont indispensables aux gardians, les gardiens de troupeaux de taureaux et de chevaux élevés en semi-liberté. Ces cavaliers utilisent leurs montures pour diverses tâches, notamment le tri du bétail, la ferrade (marquage au fer rouge) et la surveillance des manades. Cette relation étroite entre le gardian et son cheval est emblématique de la culture camarguaise.
La riziculture
La riziculture en Camargue, initiée au XIIIᵉ siècle, a connu un essor significatif pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, près de 20 000 travailleurs forcés indochinois furent réquisitionnés par la France pour soutenir l'effort de guerre. Parmi eux, environ 500 furent envoyés en Camargue à l'automne 1941, où leur expertise permit de développer la culture du riz. Leur contribution a été déterminante dans l'établissement durable de la riziculture camarguaise.
Aujourd'hui, la riziculture est prédominante, avec environ 12 000 hectares dédiés à la culture du riz. Cette activité dépend d'un réseau d'irrigation complexe, essentiel pour gérer la salinité des sols et assurer des récoltes abondantes.