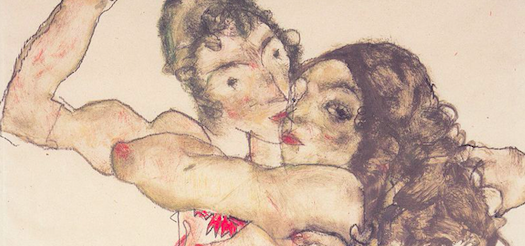B) Les facteurs sociaux
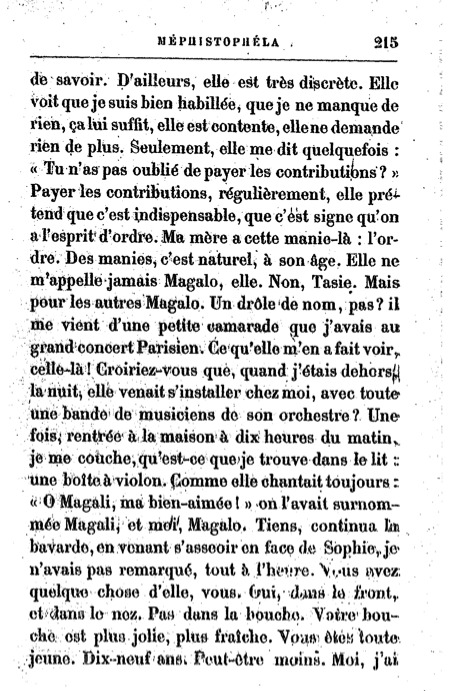
Catulle Mendès, Méphistophéla : roman contemporain, Paris, E. Dentu, 1890, p. 215, Paris, Bibliothèque nationale de France.
L'effet de groupe et la culture lesbienne
La première rencontre du personnage avec un autre personnage lesbien marque un tournant dans sa vie, une initiation à un savoir lesbien partagé entre plusieurs femmes. Les lesbiennes sont rarement représentées seules, mais plutôt en groupes, formant une sorte de gynécée, un espace autonome et réservé aux femmes, évoquant un monde où elles vivent ensemble, partagent le même mode de vie teinté d’érotisme. L'isolement des femmes renforce la curiosité des hommes. De plus, ce monde féminin est marqué par des rites de passage, comme le changement de prénom, symbolisant la transition de la femme hétérosexuelle à la lesbienne. Ainsi, dans Méphistophéla : roman contemporain (1890) de Catulle Mendès, Sophie devient Sophor pour marquer son entrée dans l'univers lesbien. Ce surnom, parfois choisi par une première lesbienne rencontrée, renforce le sentiment d'appartenance et symbolise des liens amoureux, comme le montre l'évolution de Sophie en Magalo, pour son amante Magali :
« O Magali, ma bien-aimée! on l'avait surnommée Magali, et moi, Magalo » (p. 215).

Pierre Louÿs, Les chansons de Bilitis, trad. du grec, Paris, E. Fasquelle, 1900, p. 115, Paris, Bibliothèque nationale de France.
La déception des hommes et la quête de sororité
Le lesbianisme dans la littérature peut être expliqué par la déception des femmes face aux hommes, les poussant à rechercher des relations moins violentes avec d'autres femmes. Cette théorie réduit le lesbianisme à une réaction passive tout en soulignant la maltraitance subie par les femmes. Les femmes, après avoir subi une trahison, se tournent vers l'amour lesbien. Les chansons de Bilitis (1900) de Pierre Louÿs exprime également un mépris pour l’homme jugé « violent et paresseux » (p. 115). La prise de conscience des inégalités de genre, alimentée par le féminisme, renforce ce rejet. La sororité, vue comme un refuge face au sexisme, devient un espace de soutien et d'indépendance. Le lesbianisme, parfois perçu comme un refuge, est cependant réducteur et souvent exploité dans des récits voyeuristes.
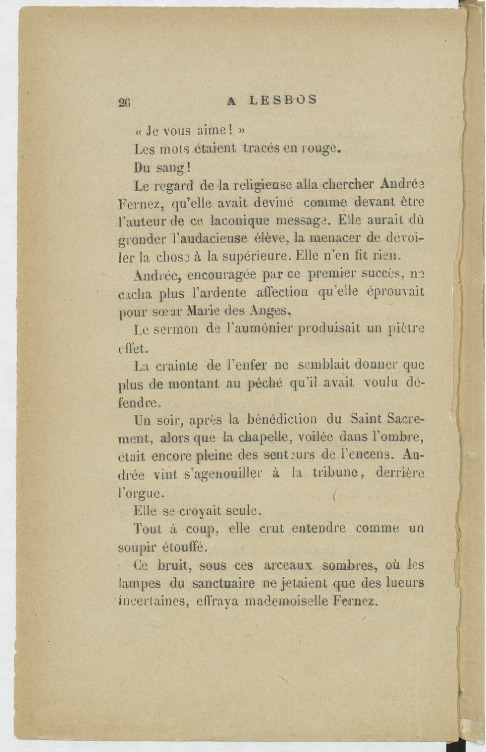
Jehan de Kellec, À Lesbos, Paris, Librairie B. Simon, 1891, p. 26, Paris, Bibliothèque nationale de France.
La fréquentation du couvent
Un schéma récurrent dans les récits sur l'origine de l'homosexualité féminine est celui de la jeune fille renvoyée de son internat après avoir entretenu des relations lesbiennes, souvent avec une camarade ou une professeure. L’éveil à la sexualité féminine y est souvent décrit comme une bêtise de couvent, marquée par des caresses timides. Le cadre scolaire et la relation élève/professeure sont fréquents. Ce schéma associe souvent l’homosexualité à une relation de pouvoir. Les auteurs décadents utilisent les institutions religieuses, comme les couvents, comme symboles de débauche et de perversion, transformant ces lieux en espaces de déviance. Dans l’imaginaire collectif, le couvent devient ainsi associé à l’épanouissement lesbien. On peut ainsi citer la passion qu’Andrée développe pour sœur Marie des Anges dans À Lesbos (1891) de Jehan de Kellec :
« Encouragée par ce premier succès, ne cacha plus l'ardente affection qu’elle éprouvait pour sœur Marie des Anges. Le sermon de l’aumônier produisait un piètre effet. La crainte de l’enfer ne semblait donner que plus de montant au péché qu’il avait voulu défendre. » (p. 26)