Affirmer le pouvoir royal et commémorer les évènements officiels

Jacques Guay, Le triomphe de Fontenoy, 1745, cornaline, intaille, 1,4 x 1,8 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, BnF Paris, France ; n° inventaire : inv.58.2499bis / REG.M.2940 ; Crédits photo : © Base Daguerre.
Jacques Guay grave des sujets allégoriques dès sa nomination par Louis XV en 1745, en tant que graveur du roi. Ses gravures marquent les grands évènements du règne du roi, comme ses victoires militaires : la bataille de Fontenoy en 1745, la bataille de Lawfeld en 1747 et la bataille de Lutzelberg en 1758. Les mêmes symboles du triomphe figurent d’une pierre à une autre : une date et un nom sont gravés sur certaines pierres pour rappeler l’évènement. La Victoire ailée, allégorie antique, tient dans sa main une couronne de laurier (qu’elle s’apprête à poser sur la tête de Louis XV) dans les Préliminaires de la paix. Dans la Victoire de Lawfelt, elle tient dans sa main droite une flèche pointée en direction des blasons des ennemis vaincus et marche sur ces derniers. Dans le Triomphe de Fontenoy, la Victoire tient dans sa main gauche les palmes du triomphe et suit le quadrige de Louis XV, représenté à l’antique et tenant dans sa main gauche un bâton de commandement. Avec de tels attributs, le roi figure en véritable chef militaire victorieux et le caractère impérial de la représentation inscrit le monarque dans la tradition des grands guerriers et souverains de l’Antiquité. Seule la Victoire de Lutzelberg, propose une représentation différente et moins explicite : un globe aux armes du roi de France (les trois fleurs de lys) symbolise le monarque. Ce globe est porté au sommet d’une colonne, elle-même ceinte de deux palmes de la victoire. La puissance militaire du royaume de France est aussi incarnée par les canons représentés sur quelques intailles.

Jacques Guay, « Les préliminaires de la Paix de 1748 »,1748, Paris, sardoine, intaille, 2,8 x 2,3 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; n° inventaire : inv.58.2499 ; Crédits photo : © Base Daguerre, © BNF.

Jacques Guay, « La Victoire de Lawfelt »,1747, Paris, calcédoine, intaille, 2,4 x 1,9 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; n° inventaire : inv.58.2498 ; Crédits photo : © Base Daguerre, © BNF.
Néanmoins, le caractère conquérant et guerrier du roi est aussi contrebalancé par les représentations du monarque en tant que pacificateur : les Préliminaires de la Paix de 1748 montrent à la droite de Louis XV l’allégorie de la Paix remettant les rameaux d’olivier au roi. Enfin, il est possible de voir dans les nombreuses représentations d’Offrandes au dieu Terme, gardien des bornes et des territoires, une célébration de la paix et de l’entente entre la France et les pays voisins avec laquelle elle a mené des guerres au cours de l’époque moderne.
Ainsi, les représentations guerrières et pacificatrice du roi soulignent sa puissance et ses compétences diplomatiques afin de légitimer son pouvoir. Ces deux visages du roi font parties intégrantes d’un code moral et de conduite que se doit d’incarner le monarque : le « roi de guerre » et « le roi de paix » sont les deux visages qui ont été attribués à son prédécesseur, Louis XIV, par plusieurs historiens tels que Joël Cornette ou Jean-Pierre Bois. Cette double qualification a été discutée pour d’autres souverains comme François Ier, à l’occasion du LVIIIe colloque international d’études humanistes.
La représentation du roi victorieux, clément et vecteur de la prospérité de son peuple, est l’expression d’une véritable idéologie royale. Les testaments des souverains attestent de la juste mesure que doivent incarner leurs héritiers sur ces deux conduites. Le testament de Louis XIV s’adresse à son arrière-petit-fils, le Dauphin Louis (futur Louis XV) en ces termes : « Comme par la miséricorde infinie de dieu, la guerre qui a pendant plusieurs années agité notre royaume avec des événemens différens et qui nous ont causé de justes inquiétudes, est présentement terminée, nous n’avons présentement rien plus à cœur, que de procurer à nos peuples le soulagement que le temps de la guerre ne nous a pas permis de leur donner, les mettre en état de jouir long-temps des fruits de la paix, et éloigner tout ce qui pourroit troubler leur tranquillité ». Toutefois, l’image du roi guerrier subsiste : le contexte politique de l’époque entraîne Louis XV dans la guerre de Succession d’Autriche et à s’exposer personnellement face à l’ennemi (en particulier à la bataille de Fontenoy en 1745). La popularité du roi surnommé « le bien aimé » connaît son apogée entre 1744 et 1748. Cette posture du roi de guerre « est consécutive de la série de stéréotypes qui ont forgé l’imaginaire de gloire d’une royauté à trois fonctions : paternelle, justicière, protectrice et victorieuse ». Pour rappel, cet « imaginaire glorieux de la monarchie » est inscrit dans les arts, notamment dans les pierres gravées par Jacques Guay. Sa mécène, la marquise de Pompadour, reconnue favorite de Louis XV en 1745, participe à entretenir et à véhiculer l’image du roi victorieux et bon avec ses sujets en utilisant les arts comme médiateurs. Toutefois, l’image du dit « bien aimé » se détériore et Louis XV connaît de sévères critiques de l’opinion publique depuis les années 1747 et 1748. Les mauvaises récoltes, le traité d’Aix-la-Chapelle apportant une paix figée, les excès financiers et le rôle politique de la marquise de Pompadour mécontentent fortement le peuple. Cette détérioration de la gloire royale entre en contradiction avec l’image du roi véhiculé dans les arts de la cour et par Madame de Pompadour.
Les pierres gravées sont donc ici des supports à caractère officiel pour démontrer l’autorité du monarque et marquer l’omnipotence du royaume de France. Cette mise en scène du pouvoir royal est également rencontrée dans les portraits du souverain, systématiquement représenté la tête ceinte d’une couronne de laurier, symbole d’immortalité et de la gloire. La Suite d’estampes de Madame de Pompadour révèle que Jacques Guay gravait d’autres monarques couronnés de lauriers comme Henri IV ou Roi de Pologne Frédéric-Auguste. Aussi, les pierres gravées, relatives aux statues équestre et pédestre de Louis XV (la première installée à Rouen, place de l’hôtel de ville en 1758 et la seconde, érigée place de la Concorde en 1763) célèbrent par les sujets et les attributs représentés la grandeur et la prospérité du règne de Louis XV. La justice qu’incarne le roi, est rencontrée dans quelques ouvrages de Jacques Guay sous la forme d’une balance.

Madame de Pompadour (d’après Jacques Guay), "Portrait de Frédéric-Auguste Roi de Pologne, Electeur de Saxe" ; in : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy, Paris, 1775, fol. 15r. Source : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy | Gallica (bnf.fr)

Madame de Pompadour (d’après Jacques Guay), "Buste de Henri IV" ; in : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy, Paris, 1775, fol. 18r. Source : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy | Gallica (bnf.fr)

Jacques Guay, "La France au pied de la statue équestre de Louis XV", 1763, matière non identifiée, camée, 1,9 x 1,4 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; n° inventaire : Camée.662 ; Crédits photo : © Gallica, © BNF.
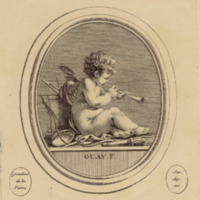
Madame de Pompadour (d’après Jacques Guay), "l'Amour se tranquilisant sur le règne de la Justice" ; in : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy, Paris, 1775, fol. 52r. Source : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy | Gallica (bnf.fr)
Jacques Guay a réalisé des portraits d’autres souverains ou de membres de la famille royale notamment pour célébrer des évènements particuliers. Le portrait du Dauphin de France et de sa femme Marie-Josèphe de Saxe sur un camée en sardoine célèbre l’union des deux époux : le dauphin et le hibou gravés sur la pierre sont leurs attributs. Trois pierres sont dédiées à leur fils Louis XVI, dont l’une célèbre. Quant à la reine Marie-Antoinette, elle figure sur une intaille et un camée du glypticien.

Jacques Guay, "Génie cultivant le laurier", av. 1757, agate, intaille, 0,9 x 0,6 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; N° inventaire : Camée.663 ; Crédits photo : © Gallica, © BNF.
Aussi, le glypticien royal identifie indirectement des personnes ou des nations dans ses productions en utilisant le système des armoiries : Par exemple, la France, incarnée par un personnage féminin ou un enfant (putto ou génie) est très souvent accompagnée d’un blason ou d’une sphère, orné des trois fleurs de lys qui la représentent. D’autres symboles issus de certaines armoiries figurent parmi les camées et les intailles : le camée du Génie cultivant un laurier présente une tour sur le pot, un élément composant les armes de la marquise de Pompadour. Un dauphin est aussi gravé sur le foyer des intailles Vœux pour la France pour le rétablissement de Monseigneur le Dauphin et Action de Grâce pour la convalescence de Monsieur le Dauphin ; il s’agit de l’animal-emblème du Dauphin de France.
Si toutes ces productions de Jacques Guay ont un rôle mémoriel pour commémorer les grands faits militaires et politiques du règne de Louis XV, la plupart de ces intailles ont été commandées ou influencées par la marquise de Pompadour. Les sujets gravés cherchent à soutenir la politique du roi. Ainsi, ces pierres fines gravées témoignent de l’amour et l’amitié de la favorite royale pour le souverain et renferment également une part d’intimité.





