Usages et usures des pierres gravées
Les pierres gravées pouvaient être serties sur différents supports. Une majorité d’intailles sont serties sur des bagues ou d’autres objets pour servir de sceaux ou de cachets. Les inscriptions inversées de dates, de signatures ou de devises sont un indicateur pour cette utilisation des intailles. Néanmoins, cet indicateur n’est pas systématique : les intailles de La Victoire de Lawfelt et des Préliminaires de la Paix de 1748 sont certes, représentées avec des inscriptions inversées mais elles ont été serties sur des bracelets de la marquise de Pompadour pour servir de fermoirs. Aucune source ne précise l’utilisation de ces pierres en tant que cachets d’autant plus que leur monture ne permet pas l’utilisation des pierres comme tel : la surface gravée de la pierre est en retrait par rapport à la monture (d’origine) en forme de couronne de laurier. Ainsi, ces intailles figurent sur ce bracelet en tant qu’élément esthétique.
Les pierres gravées pouvaient être serties sur différents supports. Une majorité d’intailles sont serties sur des bagues ou d’autres objets pour servir de sceaux ou de cachets. Les inscriptions inversées de dates, de signatures ou de devises sont un indicateur pour cette utilisation des intailles. Néanmoins, cet indicateur n’est pas systématique : les intailles de La Victoire de Lawfelt et des Préliminaires de la Paix de 1748 sont certes, représentées avec des inscriptions inversées mais elles ont été serties sur des bracelets de la marquise de Pompadour pour servir de fermoirs. Aucune source ne précise l’utilisation de ces pierres en tant que cachets d’autant plus que leur monture ne permet pas l’utilisation des pierres comme tel : la surface gravée de la pierre est en retrait par rapport à la monture (d’origine) en forme de couronne de laurier. Ainsi, ces intailles figurent sur ce bracelet en tant qu’élément esthétique.

Jacques Guay, Cachet de Louis XIV, 1793 (avant), cornaline, intaille, dimensions inconnues, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; n° inventaire : Camée.944 ; Crédits photo : © BNF.
Les intailles issues de collections muséales et montées en cachet (autre qu’en bague) rassemblent le cachet de Louis XV, le cachet de Madame de Pompadour et l’intaille de l’Offrande au dieu Terme. Le cachet de Louis XV présente une intaille gravée sur une seule face de la pierre, sertie sur une poignée (son support d’origine). A l’inverse, le cachet de Madame de Pompadour est gravé sur les trois faces de la topaze. La forme de la pierre ne permet pas son sertissage sur une bague. Les trous situés sur les deux extrémités de la pierre indiquent que la pierre devait être tenue en tenaille par des griffes. Cela lui permettait de se mouvoir en rotation et de changer de face pour pouvoir imprimer les différentes empreintes. Quant à l’intaille de l’Offrande au dieu Terme, son emploi est connu grâce aux notes manuscrites de Jacques Guay dans l’exemplaire de la Suite d’estampes de Madame de Pompadour que possède Jean-François Leturcq : « Madame de Pompadour a cette Pierre montée en cachét ». Actuellement, cette pierre est sertie uniquement d’un simple cerclage de métal doré.

Jacques Guay, Cachet de Madame de Pompadour, "L'Amour et l'Amitié", 1753, topaze, intaille, 1,4 x 1 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; n° inventaire : inv.58.2504 ; Crédits photo : © Base Daguerre, © BNF. Deux trous sont visibles à l'extrémité inférieure et supérieure de la pierre.

Jacques Guay, Foudre et Caducée, 1758, cornaline, intaille, 3,1 x 3 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; N° inventaire : inv.58.2497 ; Crédits photo : © Mathilde Avisseau-Broustet.
Les intailles rassemblent une grande quantité de pierres dont l’usage est inconnu. Les intailles sont particulièrement associées aux bagues tout au long du XVIIIe siècle. Une pendeloque a été identifiée : l’intaille du Foudre et Caducée bien qu’elle ne comporte pas de signature de Jacques Guay, a été attribuée au glypticien par Anatole Chabouillet en 1858 puis par Jean-François Leturcq en 1878. La monture de la pierre possède une bélière permettant à l’objet d’être suspendue.

Jacques Guay, Louis XV, 1750 (vers), sardonyx, camée, 2,5 x 2 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; N° inventaire : Camée.926 ; Crédits photo : © Base Daguerre, © BNF.
L’utilisation des camées est aussi variée que celle des intailles. A l’instar de ces dernières, ils sont rencontrés sur des accessoires vestimentaires (bagues et bracelets) et avec des montures simples (cerclage de métal doré).
Sur quelques portraits de la marquise de Pompadour par François Boucher, les camées sont montés sur des bracelets à rangs de perle. Chaque bracelet contient une pierre gravée (certainement par Jacques Guay). Le portrait de 1758 présente un camée dont la monture, la taille et la forme du buste du sujet de la pierre rappellent l’un des portraits de Louis XV sur sardonyx. Néanmoins, les couleurs de la pierre sur le portrait de Madame de Pompadour (à deux couches, rose et blanche) ne correspondent pas avec celles de la sardonyx conservée à la Bibliothèque nationale de France (à trois couches, noire, blanche et brune). Il pourrait s’agir d’une réinterprétation de la pierre par l’artiste ou d’un autre camée. Sur un autre portrait peint en 1756, un camée est porté en pendeloque au bout d’une chaîne, sous la ceinture. Le sujet représenté semble dessiner les traits d’un portrait (probablement Louis XV). La présence indirecte du roi dans les portraits de la marquise est un moyen discret pour la favorite de montrer son attachement pour le souverain.

Jacques Guay, "Louis XV", 1793 (avant), cornaline, intaille, 1,7 x 1,3 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; N° inventaire : inv.58.2496.2 /REG.Y5898 ; Crédits photo : © Mathilde Avisseau-Broustet. La pierre est sertie sur une bague contemporaine.
Enfin, la plupart des pierres conservées à la Bibliothèque nationale de France ont conservé leur monture d’origine. Si les montures ont pour fonction de fixer les pierres sur un objet, un simple cerclage en métal doré permet de protéger sommairement les pierres des chocs. Seules quelques gemmes ont revêtu de nouvelles montures. L’un des portrait de Louis XV sur cornaline aurait été serti sur une bague contemporaine en or, par le donateur de la pierre. Quant au grand camée de Louis XV, la première planche de la Suite d’estampes de Madame de Pompadour montre que la pierre était à l’origine sertie sur une monture en forme de couronne de feuillage, probablement en or et avec un ruban noué au sommet. Cette monture est très similaire à celle rencontrée sur le camée intitulé La France au pied de la statue équestre de Louis XV. Le grand portrait de Louis XV a été serti sur une nouvelle monture en or émaillé, dans le style de l’orfèvre et médailleur Josias Belle. Elle serait issue des collections royales de Louis XIV.

Jacques Guay, "Louis XV", 1753, sardonyx, camée, 7,4 x 5,9 cm, Département des médailles, monnaies et antiques, Bnf, Paris, France ; N° inventaire : Camée.926 ; Crédits photo : © Gallica, ©BNF. La pierre est sertie sur une monture de Josias Belle.
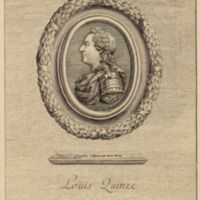
Madame de Pompadour (d’après Jacques Guay), "Portrait de Louis XV" ; in : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy, Paris, 1775, fol. 1r ; Source : Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour d'après les pierres gravées de Guay, graveur du Roy | Gallica (bnf.fr)







