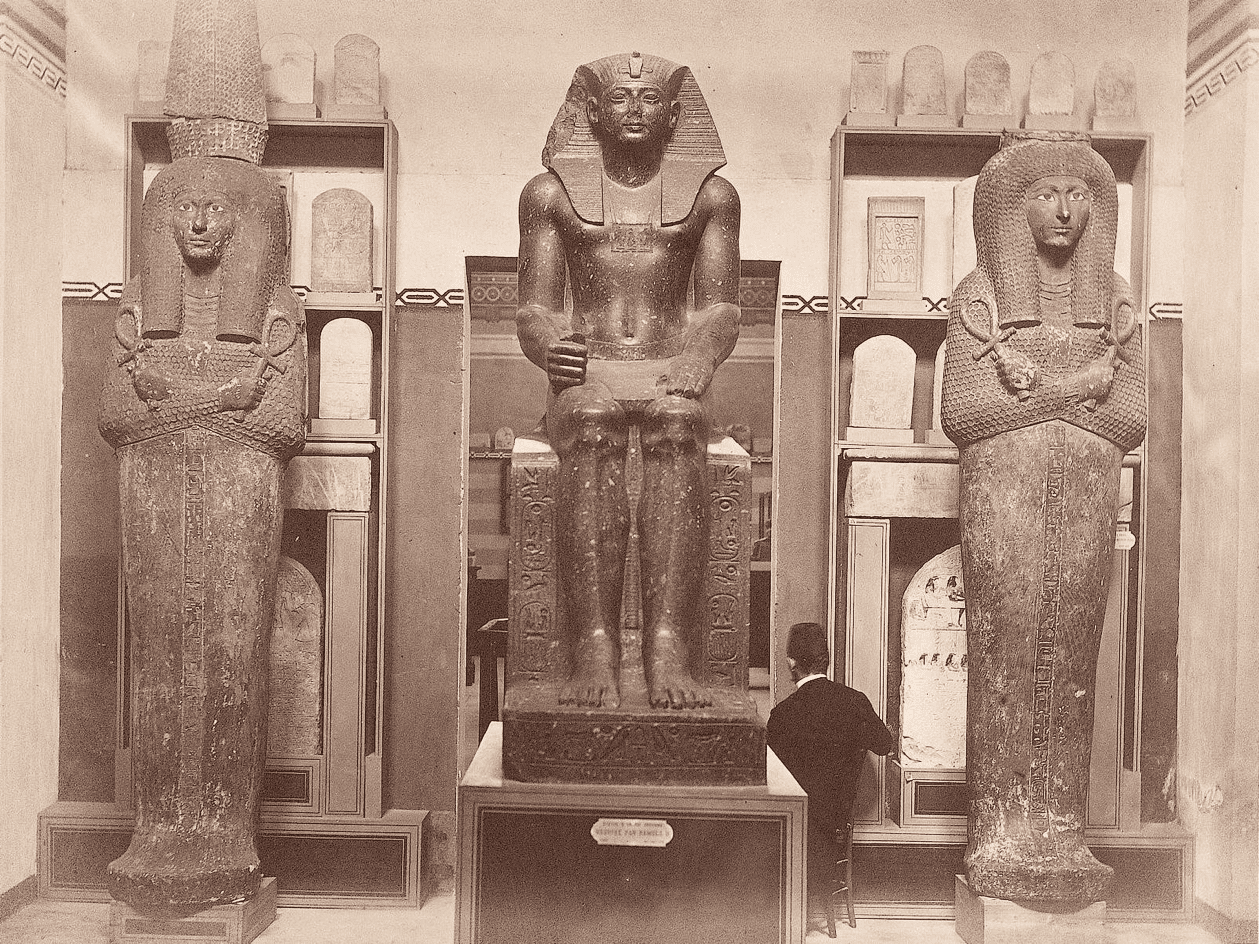Les espaces d’étude
Au musée de Būlāq, une petite salle d’étude permet observer des objets de plus près sur demande du conservateur [286]. Ceci n’est pas renouvelé au musée de Giza. Le musée à Kasr el- Nil est le premier à devenir un centre scientifique plus complet grâce à la création d’une bibliothèque. Elle dispose de 500 à 600 ouvrages en 1900 et de 9000 à 10 000 en 1910. Une bibliothécaire organise ce lieu à partir de 1902. Son fonds s’enrichit par achats et échanges avec des institutions savantes ou universitaires étrangères. Gaston Maspéro « notre bibliothèque à continuer de s’enrichir : elle a acheté ou reçu en don, cette année, un millier de volumes et de brochures nouvelles. » [287] Elle acquiert également des photos, à l’instar du fond Beato en 1907. En 1910, pendant l’hiver la bibliothèque accueille généralement six à huit lecteurs par jour. [288] La taille réduite des espaces des musées de Būlāq et de Giza, les travaux constants au musée égyptien du Caire et l’afflux permanent de nouvelle acquisition engendrent des difficultés autour de la conception de parcours de visite cohérents et clairs pour les visiteurs. Le même modèle de parcours est repris dans le trois musées mais de manière toujours plus poussée grâce à un plus grand espace pour le déployer et aux nouvelles connaissances. Il s’agit d’une alternance entre salle pour plaire au visiteur mettant en avant la valeur esthétique sans classement particulier, des salles réunissant des thématiques hétéroclites et des salles chronologiques. Dans ces deux dernières logiques de présentation, l’archéologie et l’aspect scientifiques sont mis en avant avec une réelle valeur didactique pour les visiteurs. Ceci est renforcé par les différents livrets de visite qui ne sont pas seulement des descriptifs d’œuvres mais intègrent des clés de compréhension politique, culturelle et chronologique de la civilisation antique égyptienne. Cependant, si le public égyptien est considéré et pris en compte dans la conception des ressources muséographiques, le public européen est placé en premier plan avant l’égyptianisation du service dans les années 1920. L’aspect didactique est renforcé au musée égyptien du Caire grâce à la bibliothèque. Les directeurs français des musées d’Antiquités égyptiennes du Caire tentent dans la mesure des moyens financiers mis à leur disposition, de créer des espaces les plus adaptés possible à la protection et la diffusion des collections archéologiques égyptiennes. L’évolution des localisations et des lieux montrent l’investissement croissant dans la protection du patrimoine. Le cadre architectural, l’ornementation et le décor sont dans un premier temps totalement égyptianisés puis reflètent des codes européens classiques, miroirs des dynamiques d’influence européenne à l’œuvre dans le pays à la même période. Les multiples risques encourus par les monuments permettent une identification plus rigoureuse des dangers et des réponses appropriées pour les prévenir, malgré les difficultés pour les mettre en œuvre. En dehors de cet aspect relatif à la protection des collections, assurer la diffusion des connaissances tient à cœur aux directeurs qui sont avant tout égyptologues. Cette préoccupation se reflète grâce à des idées novatrices, des parcours de visites réfléchis et documentés. Les difficultés engendrées par le manque de place et les travaux donnent néanmoins lieu à des espaces encombrés avec une certaine confusion autour de cette diffusion.
286. Mariette Auguste, Notice des principaux monuments exposés dans les galeries provisoires du Musée d’antiquités égyptiennes de S. A. le vice-roi à Boulaq, Alexandrie, 1886, p. 50, cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p 38. ↩
287. Gaston Maspero, « 1903 », Rapport du service du Service Des Antiquités Égyptiennes de 1899 à 1916, Le Caire, copie au Louvre, 4°B808 et 4°B 587 (7,1), p. 112. ↩
288. David Élisabeth, 1999, op. cit., p. 236. ↩