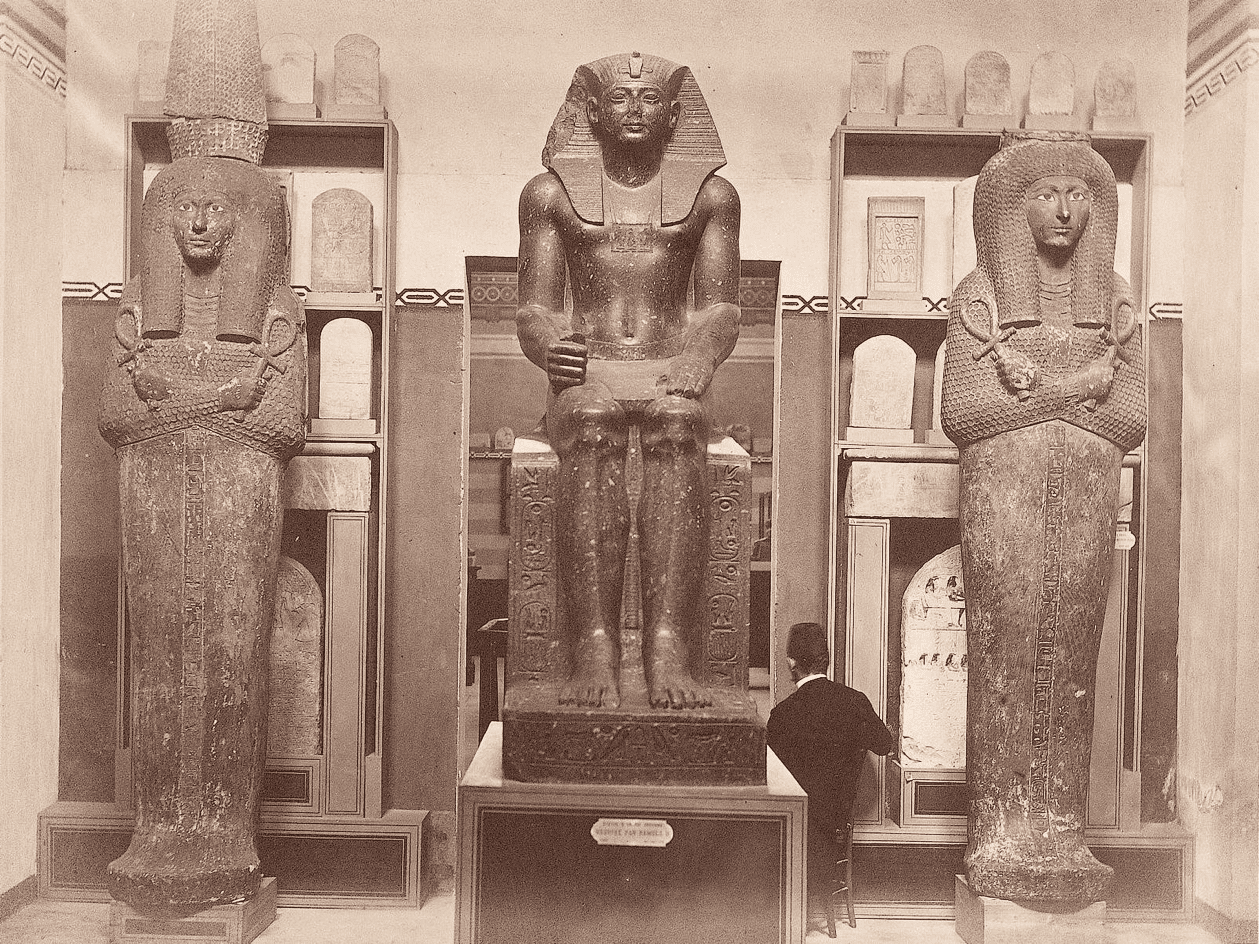Penser la conservation préventive dans la construction
Le programme de construction du musée à Kasr el-Nil semble en effet tirer les leçons des mauvaises expériences précédentes. [222]. L’organisation du musée et la conception des éléments qui le composent, telles que reflétées par les termes du concours, doivent participer à protéger les collections. La parcelle n’est pas en bordure direct du Nil afin d’éviter inondation et humidité. Le programme souligne la nécessité d’une ventilation efficace avec la conscience du climat et des vents du Caire porteurs d’une fine poussière. Les œuvres ont été conservées pendant des millénaires grâce à la siccité du désert. Le programme propose de retrouver cette qualité climatique à l’intérieur de l’édifice, ce qui est remarquable et innovant pour la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, le bois est proscrit afin d’éviter tout risque d’incendie et la mosaïque de ciment est recommandée pour les sols pour afin d’offrir un support résistant et stable [223]. Dans ce programme le musée est plus qu’un lieu de présentation, il devient un véritable lieu de conservation raisonnée. L’édifice doit être fonctionnel grâce à des circulations spacieuses, des hauteurs adaptées aux collections, des espaces de stockage suffisants, des conditions de sécurité, d’exposition et d’éclairage adéquates. Malgré cette solide préparation en amont, le chantier du musée est catastrophique et met en danger les collections. Dans le rapport sur la marche du S.A.E. de 1902 [224]. Gaston Maspero décrit les problèmes posés par le bâtiment : (...) le système d’éclairage est défectueux et devra être réformé promptement, si l’on veut éviter que l’excès de chaleur et de lumière n’endommage ou même ne détruise nombre des monuments pendant les mois d’été ; il n’est pas certain non plus que les toits soient à l’épreuve de l’eau, et les pluies médiocres que nous avons eues pendant les derniers jours de décembre 1902 ont filtré dans quelques salles de l’étage supérieur. Enfin, la surveillance y est assez difficile. Comme l’observe justement Maspero, la toiture n’est pas assez solide. Cela est dû à l’utilisation du ciment armé, technique encore trop récente, qui se révèle trop ambitieuse pour un édifice de cette ampleur et qui n’est pas maîtrisée lors de la construction. [225]. Les poutres de la galerie centrale fléchissent jusqu’à finir par laisser l’eau pénétrer à travers le ciment du plafond et ronger les fers de ses armatures. « Le 2 avril 1905, un violent orage inonda la galerie d’honneur et les salles adjacentes. Faute de crédits, on se contenta de rendre les terrasses étanches avec du mâchefer et du bitume. » [226]. De plus le terrain n’est finalement par réellement adapté car il est humide. Au moment de la construction une semelle de béton de deux mètres d’épaisseur est réalisée au-dessus du sous-sol du bâtiment principal qui lui-même « doit isoler le rez-de- chaussée, mais aussi servir à rafraîchir et ventiler l’étage par des gaines d’aération montant l’air frais du sous-sol à l’étage. » [227]. Ces problèmes sont résolus par des travaux successifs. La surveillance est renforcée pour éviter les vols par le déploiement de quatre-vingt-cinq gardiens [228]. mais « en (les) obligeant (...) à porter un uniforme à l’occidentale au lieu d’une ample galabia munie de poches intérieures, on limite les risques de disparitions de petits objets. » [229]. La lumière est adoucie par une reprise de toutes les ouvertures au plafond et au sol, les baies placées aux deux extrémités de la galerie d’honneur sont par exemple rétrécies [230]. mais également une modification de la teinte des peintures [231]. La correction de la toiture est décidée en 1908 et achevée en 1909, les poutres défectueuses en ciment armé sont remplacées par des poutres en fer plus classique [232]. Entre décembre 1910 et 1914, l’atrium central est reconstruit ainsi que tous les plafonds qui sont repris un par un [233]. Bien que les mouvements d’œuvres soient à éviter pour les préserver, les collections sont souvent déplacées de salles en salles en raison de tous ces travaux. Si en amont de la construction, des recommandations pertinentes sont formulées sur la conception d’un espace protégeant au mieux les collections et tirant les leçons des erreurs des musées précédents, celles-ci n’ont pas suffi. En témoigne la construction du musée qui n’est pas immédiatement correctement réalisée. Les risques majeurs qu’encourent les collections durant les deux premiers projets muséaux sont donc clairement identifiés par le personnel qui cherche à y remédier par des travaux. Cela amène à mieux prendre en compte les dangers dans le programme du troisième musée, en particulier ceux relatifs aux inondations et aux incendies. Celui-ci vise à concevoir un musée apte à protéger les collections de ces risques dès la conception du bâtiment même si cette volonté se heurte à des problèmes dans l’exécution de sa réalisation. L’évolution dans l’identification et la prise en compte progressive des risques tout au long de l’élaboration et du développement des trois musées est un exemple significatif des réflexions sur la manière de penser l’environnement des collections en fonction de l’impact que cet environnement a sur elles à ce titre, représente les prémices des principes futurs de la conservation préventive.
222. Ibid., p. 30. Sur le détail du programme du concours, l’article de Fakhrî Husayn, Programme du concours ouvert par le gouvernement égyptien pour l'érection d'un musée des Antiquités égyptiennes au Caire, dans Ezio Godoli et Mercedes Volait (eds.), 2017, op. cit., p. 41-44. ↩
223. Le sol est finalement réalisé avec une technique mixte où prédomine la pierre. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 247. ↩
224. Gaston Maspero, « 1902 », Rapport du service du Service Des Antiquités Égyptiennes de 1899 à 1916, Le Caire, copie au Louvre, 4°B808 et 4°B 587 (7,1), p. 80. ↩
225. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 248. ↩
226. Ibid., p. 263. ↩
227. Ibid., p. 247. ↩
228. Morlier Hélène, 2017, op. cit., p. 234. ↩
229. David Elisabeth, Gaston Maspero : 1846-1916 : le gentleman égyptologue, Pygmalion-Gérard Watelet, Paris, 1999, p. 234. ↩
230. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 247. ; Tiradritti Francesco, Trésors d’Égypte : les merveilles du Musée égyptien du Caire, Paris, Gründ, 1999, p. 23. ↩
231. Morlier Hélène, 2017, op. cit., p. 234. ↩
232. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 263. ↩
233. Ibid. ↩