Le théâtre et l'opéra
Le théâtre du XIXᵉ siècle a également contribué à populariser la figure de Marguerite de Valois, en mettant en scène ses amours tumultueuses et sa position délicate dans les intrigues de la cour. Des pièces historiques ont fait d’elle un personnage secondaire fascinant, tiraillée entre ses sentiments et son destin politique.
Dumas ne se contente en effet pas d’écrire un roman : en 1847, La Reine Margot est adaptée au théâtre, confirmant la popularité du personnage. Le théâtre du XIXᵉ siècle, accessible à de nombreuses classes sociales, joue un rôle central dans la diffusion des mythes historiques et littéraires.
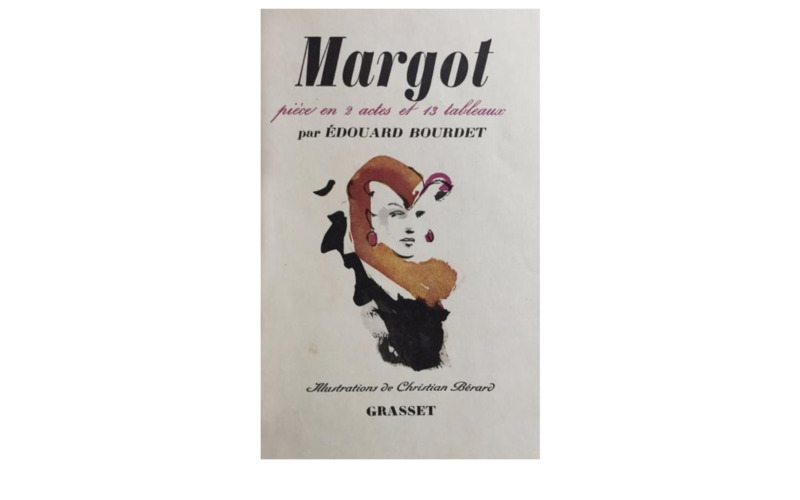
Affiche de Margot, pièce d'Édouard Bourdet, Illustration de Christian Bérard, 1936, Maison de Vente Ader-Paris
Le théâtre attire un public varié, des élites aux classes populaires. L’adaptation de La Reine Margot permet donc d’ancrer l’image d’une Marguerite passionnée, intrépide et tragique dans l’imaginaire collectif. La représentation théâtrale donne un nouveau souffle au personnage : Marguerite de Valois prend corps à travers des actrices qui, en fonction de leur interprétation, renforcent certains aspects du mythe. Tantôt noble et émouvante, tantôt perfide et manipulatrice, elle devient une figure que le public s’approprie, contribuant à fixer son image dans l’histoire du spectacle.
Plus tard, au XXᵉ siècle, des pièces comme Margot d’Édouard Bourdet (1935) témoignent d’une persistance du mythe. La Marguerite des planches est une femme de caractère, oscillant entre sensualité et intelligence politique, reflétant encore une fois les ambivalences du personnage.
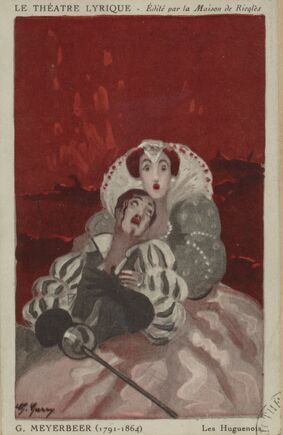
Carte postale pour Les Huguenots, opéra d'Eugène Scribe et Giacomo Meyerbeer, lithographie couleur, 1836, conservé à la Bibliothèque nationale de France.
L’opéra n’est pas en reste : si elle ne figure pas dans Les Huguenots de Meyerbeer (1836), inspiré des événements de la Saint-Barthélemy, l’atmosphère de la cour de Catherine de Médicis et les conflits religieux y sont largement exploités, renforçant la vision d’une époque baroque, violente et passionnelle dans laquelle Marguerite est souvent associée.
Les librettistes et compositeurs romantiques ont souvent préféré s’inspirer du mythe plus que de l’histoire, rendant leurs héroïnes plus tragiques et plus passionnées qu’elles ne l’étaient dans la réalité.